Thèses sur le concept de « travail »
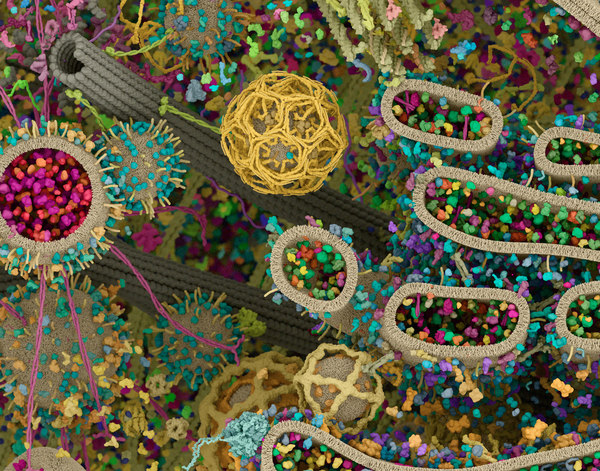
L’expérience du confinement a du moins permis à tous d’entrevoir cette vérité : les lois de l’économie ne sont pas le fruit d’une nécessité historique, mais un programme porté par des militants, susceptible en tant que tel d’être intégralement interrompu. Nombreux désormais sont ceux qui s’accordent à dire que la période récente a fait apparaître l’économie, et ses militants, comme le véritable ennemi – disons l’ennemi des habitants de la Terre (pensons au beau film de Pelechian, qui date de 1970). Mais on peut préciser davantage ce qui, dans l’économie, constitue la raison première de la dévastation du monde naturel. On dira que cette raison, c’est la mise au travail généralisée des êtres de nature. Le cœur de l’ennemi, c’est bien l’économie ; mais au cœur de ce cœur, il y a le travail. Ce qui fait la spécificité du capitalisme, au regard des formations anciennes, est pour bien des historiens la centralité accordée à la productivité du travail, et non plus à celle de la terre. Mais au-delà de ce constat, et des débats qu’il suscite entre les spécialistes, ce qu’il s’agit de voir est bien qu’aujourd’hui, la cause réelle de la consumation de la Terre est la mise au travail des êtres de nature pour le capital.
Je ne voudrais pas que cette thèse soit entendue comme une reconduction de la fameuse « centralité de la lutte capital/travail », telle qu’elle était comprise pendant toute l’existence du mouvement ouvrier révolutionnaire. Je ne voudrais pas non plus qu’elle soit entendue comme une variante de l’ontologie matérialiste, au sens où Heidegger la définit dans sa Lettre sur l’humanisme : le matérialisme n’affirme pas que tout est matière, mais que tout étant est l’objet d’un travail – et si l’on dit qu’il est aussi sujet d’un travail, on reste tout autant pris dans les impasses de cette ontologie.
Pour soutenir la thèse proposée en évitant ces écueils, je m’appuierai sur un montage, qui reliera essentiellement deux pensées à première vue disparates. La première est ancienne, elle suit le sillage de l’opéraïsme italien des années 1960, tel qu’il a été construit notamment par Mario Tronti. L’ouvrage principal de ce dernier, Ouvriers et capital, est profondément inscrit dans le mouvement ouvrier révolutionnaire, et inutilisable hors de ce contexte dans sa littéralité. Mais je pense qu’il est encore possible tirer de cet ouvrage des analogies fécondes. La deuxième est celle de Jason Moore, avec les analyses qu’il a proposées de « l’écologie-monde ».
Appropriation
Moore montre que le travail reconnu comme tel, et donc rémunéré, ne constitue qu’une faible part de ce qui fonctionne bien comme travail. Ce qui signifie que le capitalisme ne fonctionne pas seulement sur la base de l’exploitation du travail rémunéré, mais aussi sur l’appropriation d’un travail gratuit qui peut être effectué par les humains (esclavage, travail domestique) mais aussi par les non-humains (animaux d’élevage, sols ou cours d’eau, forêts ou plantations d’arbre). La mise au travail, loin de s’être limitée aux seuls humains, mobilise l’ensemble des êtres de nature. Et cela est vrai dès l’origine de l’économie-monde.
Les forêts qui ont permis le développement de la marine marchande hollandaise au XVIIème siècle, les sols qui abritent le charbon ou le pétrole (conditions de la « révolution industrielle »), le vent qui fait tourner les éoliennes, les poulets en batterie qui permettent de nourrir à bas prix une force de travail elle-même payée aussi peu que possible : autant d’exemples d’êtres de nature qui sont enrôlés dans le projet de valorisation du capital. Leur activité de production, de régénération et d’invention devient un travail dès lors qu’elle est mise au service de cette valorisation.
Or cette mobilisation des êtres de nature est telle qu’elle ne permet pas, dans la plupart des cas, leur régénération, ou celle de leurs milieux de vie. C’est cette régénération empêchée qui est aujourd’hui la source d’une crise qui paraît insurmontable aussi bien pour le capitalisme que pour la nature elle-même. Il se pourrait que les limites du capital et celles de la nature coïncident exactement. Il me semble que notre objectif est de faire que ce ne soit pas le cas, et donc de maintenir un écart entre les deux. Cet écart maintenu entre les deux limites est l’image de ce qui ferait de notre futur un temps encore susceptible d’être habité.
Quoi qu’il en soit, la pollution, la destruction de la faune et de la flore, les phénomènes désastreux qui s’accélèrent, ne sont pas des accidents, mais des effets structurels du développement capitaliste en tant que tel, et de ce qui constitue son moteur, cette mise au travail généralisée dont il importe de maintenir les pans les plus étendus dans l’invisibilité. C’est parce qu’ils sont invisibles qu’ils sont appropriables.
L’acquis décisif des thèses de Moore me semble contenu dans la distinction entre l’exploitation et l’appropriation. Toutes deux sont nécessaires au fonctionnement du capitalisme, mais les critiques du capitalisme s’en tiennent la plupart du temps à l’exploitation (au dégagement de la survaleur par le biais d’un surtravail, qui permet de réaliser des profits). Ce qui est laissé dans l’ombre, c’est un processus beaucoup plus vaste, plus étendu, qui doit se comprendre comme une mise à disposition, un embrigadement de l’activité des êtres et de leurs milieux de vie.
Il faut souligner le rôle qu’ont eus les dispositifs de connaissance de la science moderne dans la constitution d’une nature appropriable. Je ne reviens pas ici sur la question : faut-il incriminer la science en tant que telle, etc. De bons ateliers (Frédéric Lagarde et Elsa Day) ont ici (aux rencontres de Lachaud de l’été 2020) montré quel usage pouvait être fait de la démarche scientifique, ne serait-ce que pour apprendre à voir ces non-humains dont on parle tant. Le problème n’est pas celui de la (des) pratique(s) scientifique(s), mais celui de l’hégémonie conquise à partir du XVIIème siècle par le modèle de véridiction scientifique. Un modèle qui en est venu à monopoliser, dans notre culture, l’énonciation du vrai. (Je renvoie aux travaux de Foucault sur la question : Il faut défendre la société, p. 11 sq. ; Du gouvernement des vivants, p. 92 sq ; L’Herméneutique du sujet, p. 27 sq.).
L’hégémonie du modèle de véridiction scientifique a permis la constitution d’une nature appropriable précisément parce qu’elle était « extérieure ». Descola a raison de souligner que le « naturalisme » tel qu’il l’entend n’est pas réductible à une idéologie qui aurait pour fonction de légitimer un état de fait qui se jouerait au niveau des pratiques matérielles ; il doit bien plutôt être envisagé comme un ensemble d’opérations tout aussi réelles et tout aussi fondamentales, pour le devenir historique, que les pratiques de production. Ce que Descola fait mine de ne pas savoir, c’est que c’est bien à ce titre, c’est-à-dire en tant qu’ensemble d’opérations productrices de réalité, que le naturalisme doit être intégré à la description de l’économie-monde – ou, comme préfère dire Moore, de l’écologie-monde.
Travail gratuit
Ce que le capitalisme s’approprie, ce sont donc bien sûr des territoires, comme nous le montre son histoire entière depuis la « conquête du Nouveau monde ». Mais plus fondamentalement, donc, c’est le travail, c’est-à-dire comme l’indique le terme même d’« appropriation », le travail d’autrui. Toute la question est de savoir ce que signifie ici ces deux termes, « travail » et « autrui ».
On dira : le travail, dans le capitalisme, c’est l’activité qui permet, directement ou par de plus ou moins grands détours, de générer des profits pour ceux qui organisent la mise au travail des autres – disons, pour parler comme Tronti : pour la classe des capitalistes. Autrement dit, le travail, dans le capitalisme, c’est le corrélat de la mise au travail pour la « valorisation ».
Le point décisif est que le travail ainsi compris n’est pas toujours reconnu comme travail. Plus encore, il ne l’est pas pour sa plus grande part. Le travail reconnu n’est que la partie émergée de l’iceberg de la mise au travail. Moore insiste sur le fait que la sphère de l’appropriation est beaucoup plus large que celle de l’exploitation, et que c’est seulement l’écart maintenu entre les deux qui permet le développement du capitalisme. Plus précisément, puisque le capitalisme est un système dynamique : il s’est agi dans son histoire d’étendre sa zone d’appropriation plus vite que sa zone de marchandisation. C’est ce processus même qui se trouve en crise. La sphère de l’appropriation se contracte. Or s’il faut qu’elle soit maintenue plus large, c’est que par sa nature même, le capitalisme tend à épuiser ce qu’il s’approprie. Et aujourd’hui, il est incapable de contrebalancer cet épuisement. Pour autant, il ne peut renoncer à étendre toujours plus la mise au travail, l’appropriation de l’activité des êtres de nature.
Il me semble que l’insistance de Moore sur le travail invisible, sur le travail gratuit, nous permet de relire autrement les thèses développées par Negri et quelques autres depuis les années 1970, mais aussi les mouvements qui ont tenté de leur donner une prise politique. Les mouvements de chômeurs et précaires des années 1980 à 2010, qui ont pris appui sur ces thèses, ont voulu montrer que les formes du travail avaient été bouleversées avec la recomposition capitaliste qui avait suivi la fin des mouvements révolutionnaires ; mais que les grilles de lecture aussi bien des économistes au service de l’ordre libéral que des penseurs critiques, marxistes entre autres, ne permettaient pas de comprendre ce bouleversement. Il s’agissait pourtant de faire reconnaître comme travail les activités qui n’étaient pas reconnues comme telles (par exemple celle du chômeur à la recherche d’un emploi, ou celle du consommateur dans les grandes surfaces, ou sur le web).
J’évoque ces mouvements, ces luttes autour de la question du revenu, des formes nouvelles du travail, parce qu’il me semble que l’on pourrait reprendre ce qu’elles nous disent encore depuis l’analyse que fait Moore de l’appropriation. Sans doute peut-on parler d’un échec de ces luttes. Mais ce que nous permet peut-être de voir Moore, c’est que, s’il y a bien un échec, il ne tient pas au fait que ces mouvements seraient allés trop loin. Il tient au fait qu’ils ne sont pas allés assez loin sur cette voie – celle de l’analyse du travail non-payé, au-delà de l’exploitation dans ses formes classiques.
Peut-être les formes nouvelles de travail « immatériel » ou « cognitif », etc., sur lesquelles ont insisté bien des gens depuis quelques décennies, ne sont-elles que des cas particuliers d’un travail non reconnu comme tel, ce qui veut dire non-payé ; peut-être ces formes ont-elles accompagné l’histoire entière du capitalisme depuis ses origines.
Lorsque je fabrique des données en circulant sur le web, je suis mis au travail sans être constitué en force de travail. Or cette mise au travail sans constitution en force de travail n’est pas une exception ; elle n’est pas non plus le fruit de mutations récentes des conditions sociales et techniques du travail. Elle est la situation la plus générale de tous les êtres embrigadés depuis l’origine dans le développement du capital.
Refus
Résumons : ce que le capitalisme s’approprie avant tout, c’est le travail gratuit, le travail qui n’est pas reconnu comme travail. Et ce n’est pas un fait nouveau : au centre du développement capitaliste, il y a toujours eu le travail gratuit, le travail rendu invisible comme travail. Enfin, ce n’est pas seulement le travail humain qui permet cette opération. Ce qui permet de générer des profits, c’est l’ensemble des modalités du travail gratuit, du travail approprié sans qu’il soit besoin de le rémunérer, et sans qu’il soit besoin de le reconnaître comme travail.
Dès lors le problème est bien le même que celui qu’ont posé les penseurs militants de l’opéraïsme : il s’agit d’attaquer le capitalisme au cœur même de son développement, c’est-à-dire à l’endroit même de la mise au travail. Le point de départ pour les opéraïstes était la haine du travail ouvrier : « Non seulement l’ouvrier n’aimait pas son travail, mais il le détestait. Le refus du travail devenait une arme fatale contre le capital (…). La lutte contre le travail résume le sens de l’hérésie opéraïste » (Mario Tronti, Nous opéraïstes, p. 138-139). Et c’est à la description de ce refus qu’était attaché l’usage opéraïste du concept de « travail vivant ».
Ce concept ne renvoie pas à l’idée qu’il y aurait une essence humaine, et que celle-ci serait indissociable du travail compris comme unité dialectique avec la nature. Il renvoie à l’autre versant du travail, le travail objectivé ; il inscrit dans le concept même de travail la division, l’antagonisme politique. C’est en tout cas la lecture proposée par les opéraïstes notamment des Grundrisse. Une lecture donc tout autant à distance des marxistes qui voyaient dans le travail l’essence humaine que de la manière dont la critique de la valeur a, tout à l’inverse, lu les Grundrisse comme une critique de la catégorie même de « travail » comme abstraction réalisée. S’il faut garder un primat à l’analyse du travail, c’est dans la mesure où il est le lieu où l’antagonisme peut être exacerbé, porté à son plus haut point.
Il faut donc seulement étendre quelque peu le cadre historique de l’analyse (l’appropriation du travail non-reconnu ne commence pas récemment, mais est bien là dès le départ) et surtout ses acteurs (le travail n’est pas seulement humain, et pas seulement réalisé par les vivants).
Les thèses opéraïstes ont permis de relire l’ensemble de l’histoire de l’économie-monde à partir du ressort subjectif du refus du travail. C’est ainsi par exemple que Yann Moulier-Boutang peut voir l’avènement du salariat comme le fruit d’un compromis imposé aux capitalistes. Il a été imposé contre le travail contraint (esclavage, servage, etc.), et plus précisément par la fuite qui constituait la réponse active au travail contraint. L’histoire du capitalisme est celle du contrôle de la mobilité de la force de travail, une mobilité qui se comprend depuis le besoin d’échapper aux dispositifs de mise au travail.
Mais ce point de vue s’est retrouvé hors de l’héritage opéraïste. Peter Linebaugh et Marcus Rideker ont raconté l’histoire de la transition qui fait passer de la Révolution anglaise à la Révolution française à travers les récits de marins mutinés qui ont préféré vivre sur des îles sur lesquelles leur navire s’était échoué, d’esclaves marrons ou de domestiques en fuite qui ont préféré rejoindre les indigènes, de vagabonds enrôlés de force dans la marine marchande qui ont préféré rejoindre la confrérie des pirates, de comploteurs préparant une insurrection pour faire advenir un monde égalitaire. Les principes des Niveleurs n’ont pas été éteints, ils ont été emportés sur les mers, avant de revenir sur le continent européen, et de repartir aussitôt vers Haïti.
On dira cependant à juste titre qu’il est difficile de reprendre le concept de « refus du travail », ou plutôt la stratégie du refus du travail en dehors du mouvement ouvrier révolutionnaire. Un mouvement qui trouvait sa force dans la concentration spatiale des masses ouvrières. Mario Tronti revient sur ce point dans Nous opéraïstes, où il parle de la classe ouvrière comme d’une « minorité de masse ». La classe ouvrière occupait une place « aristocratique » au regard de l’ensemble du peuple – elle constituait une véritable aristocratie du peuple. Et cette place était indissociable de son lieu d’effectivité, l’usine, où se retrouvaient chaque jour les ouvriers (NO, 134).
Il est donc bien vrai que nous ne pouvons reprendre à la lettre cette thématique du refus du travail, ni même chercher à la transposer comme ont voulu le faire Negri et ses proches à travers les figures successives de l’ouvrier-masse, de l’ouvrier social, du travailleur immatériel et du cognitariat. La question est plutôt de savoir si nous pouvons reprendre le schème du refus, la grille d’ensemble de la lecture de l’économie-monde comme histoire de la fuite du travail pour le capital, sans reprendre la perspective ouvrière et ses transpositions. Autrement dit, que peut vouloir dire refuser la mise au travail pour le capital lorsque celle-ci concerne aussi bien les humains que les autres qu’humains ? Et comment ce refus peut-il indiquer une ligne antagonique centrale aujourd’hui ?
Économie
La question peut être posée autrement : elle est de savoir ce que l’on peut reprendre de la perspective opéraïste, bien après la fin du mouvement ouvrier révolutionnaire, et dans un contexte qui est celui de l’épuisement de tous les êtres de nature mis au travail pour le capital.
S’il m’a paru nécessaire de faire ce montage Moore/Tronti, c’est parce qu’il me semble qu’à l’analyse de Moore manque justement le point de vue politique. Le point de vue qui est bien sûr celui des luttes (Foucault), mais plus précisément celui de ce qui fait l’unité transversale des luttes, qui permet la clarification de la ligne de partage, de la division entre des camps ennemis.
C’est depuis cette perspective que l’on peut tout d’abord clarifier le concept même d’« économie ». Celle-ci ne renvoie pas à une infrastructure, elle ne renvoie pas à un invariant historique présent dans toute formation sociale. Elle n’est pas pour autant un voile susceptible d’être dissipé par la magie du performatif (comme le voudrait Bruno Latour). Elle est une singularité historique.
La première fois que j’ai rencontré cet énoncé, c’était dans un fascicule de Sylvain Lazarus de 1992, titré « Chercher ailleurs et autrement » (republié dans Anthropologie du nom, Seuil, 1996). J’en avais parlé à des amis issus du courant opéraïste, qui m’ont répondu que c’était exactement ce qu’ils avaient toujours dit eux-mêmes. Et en effet les textes des années 1960 peuvent être relus depuis cette assertion : l’économie n’est pas un invariant historique, elle est une configuration unique, indissociable du capitalisme et de son histoire.
Ce point de vue semble aussi se retrouver dans l’analyse des systèmes-monde, telle que Immanuel Wallerstein l’a prolongée (et que Jason Moore prolonge aujourd’hui à sont tour). Pour Wallerstein, l’économie-monde apparaît (comme singularité historique, donc) au moment où la logique de la marchandisation globale et de la valorisation du capital subordonne les logiques de souveraineté territoriale qui avaient prédominé jusqu’alors. Mais l’opéraïsme permet de faire un pas de plus : si l’économie n’est pas seulement une singularité historique, c’est parce qu’elle est une politique. L’économie, c’est la politique du capital.
On dira plus précisément : l’économie, c’est l’ensemble des techniques de gouvernement, machiniques et non-machiniques, qui organisent de façon transnationale (mais avec l’aide toujours essentielle des États) la subordination des activités humaines et non-humaines à la valorisation du capital.
Une fois clarifié le concept d’« économie », il me semble qu’on peut maintenant répondre à la question : peut-on transposer et prolonger le point de vue opéraïste au sein de l’écologie-monde actuelle ?
On pourrait dire tout simplement : il s’agit d’être les sujets du refus de la mise au travail gratuite pour le capital. La marge (calculable ou non) qui fait la part de l’exploitation dans le travail rémunéré devrait être prise comme un cas particulier de travail gratuit. Il faudrait donc inverser la logique, partir du travail non reconnu comme tel, et depuis là, lire et comprendre ce qui se passe dans le travail reconnu. Et ce qui nous sauterait aux yeux serait bien ce qui unifie le refus de laisser des territoires traversés par des pipelines ou saccagés par des projets extractivistes et le refus d’un système d’imposition qui oblige à travailler toujours plus. Une problématique commune traverse la lutte contre la 5G et les smarts grids, la défense d’une forêt et celle du « pouvoir d’achat » (en tout cas quand celles-ci prennent la forme d’une contestation globale) : celle du refus de la mise au travail gratuite.
Supplément
La question serait alors de savoir quel statut donner à cette unité. Et la difficulté serait de ne pas reconduire un type d’unification qui éteint les singularités qu’elle unifie. Les singularités de lutte, les singularités communautaires, les singularités d’expérience. Il me semble que c’est tout à fait possible si l’on s’accorde sur le statut de la supplémentation symbolique.
Dans le texte de 1967, titré « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? », Deleuze expliquait que ce courant de pensée ne s’est pas caractérisé par la mise au jour des fameuses structures, mais par la manière dont l’élément symbolique était pensé dans son irréductibilité aux deux autres dimensions – réel et imaginaire. Le problème ne pouvait plus être centralement celui du rapport entre la réalité et sa représentation (un type de problème qui revient aujourd’hui avec la grande vogue des métaphysiques « réalistes »), mais celui de l’articulation entre ces trois dimensions irréductibles.
L’un des points essentiels de cette articulation est le suivant : la supplémentation symbolique est ce qui nous permet de ne pas nous écraser sur le réel. Autrement dit, elle est ce qui nous permet de ne pas sombrer dans la psychose. L’erreur est de confondre cette supplémentation avec l’accès à un « ordre » symbolique tel que les lacaniens orthodoxes ont pu le concevoir, sur fond de dramaturgie de la castration et d’acceptation de la Loi.
Disjoindre la question de la supplémentation symbolique de cette dramaturgie réactionnaire, c’est ce qu’ont apporté me semble-t-il des penseurs comme Badiou et surtout Rancière. On peut parler de supplémentation symbolique dans la mesure où des paroles, des fragments de discours, s’ajoutent à ce qu’il y a, et permettent de nous décoller de cet « il y a », disons de ce qui est donné. Une telle supplémentation apparaît là où un sujet est emporté vers ce qui ne l’attendait pas, vers ce qui n’était pas socialement prescrit pour lui ou elle. Une parole, un bout de théorie, peut emporter une vie : voilà ce dont nous a beaucoup parlé Rancière, avec l’exemple de ces prolétaires qui se mettaient à faire des choses qui ne leur étaient pas destinées : écrire des poésies, concevoir des utopies, tenter de les mettre en œuvre, ou simplement goûter la joie de ne rien faire.
Toute la difficulté réside dans le fait que ce supplément reste irréductiblement tel, c’est-à-dire qu’il ne saurait être intégralement « réalisé ». Il y a un décalage irréductible entre discours et pratiques, et il n’y aura jamais de « réalisation » intégrale du supplément symbolique. Ce qui veut dire que le supplément symbolique ne supplémente pas seulement le réel, mais tout d’abord la pure adéquation des mots et des choses. C’est ce qui fait son importance, et c’est aussi ce qui fait qu’il est source de bien des malentendus. L’erreur des activistes un peu étroits qui disent qu’on n’a pas besoin de « théorie » est de croire qu’un sujet politique peut exister en restant collé à la passion du réel – qui prend le plus souvent la forme d’une passion logistique (qu’elle soit culinaire, hospitalière ou militaire).
L’essentiel pour nous ici est que, au plus loin de la lourde dramaturgie de la Loi, on puisse parler des accroches partielles et hasardeuses de la supplémentation symbolique. Parler ainsi, c’est supposer qu’un sujet est toujours composite. Tout sujet n’est tel que d’être pris dans une diversité (restreinte sans doute, mais toujours plurielle) d’espaces de subjectivation. C’est la manière dont il s’inscrit dans ces espaces, et la manière dont il inscrit en lui la traversée de ces espaces, qui fait de lui le sujet qu’il est.
Et c’est aussi dans ces espaces qu’il éprouve chaque fois qu’il n’est tel que d’être justement toujours plus que lui-même. C’est au sein de ces espaces qu’il fabrique avec d’autres un temps commun. On n’est sujet qu’à plusieurs.
Si cette ébauche de description est vraie, alors on peut supposer que l’unification politique du refus n’est pas vouée à éteindre les autres espaces de subjectivation. Ce qui manque dans notre contemporanéité politique, c’est l’espace de subjectivation du refus qui permettrait de dessiner une transversale entre les luttes existantes. Cet espace de subjectivation me paraît pouvoir être pensé depuis le refus de la mise au travail gratuite pour le capital. Ce refus, pour emprunter encore au vocabulaire lacanien, pourrait être vu comme le trait d’un qui relie les espaces de subjectivation politique disséminés partout dans le monde (je parle d’une dissémination géographique, mais aussi en termes de « domaines » de lutte, etc.).
Un trait d’un est un support d’identification. Ce dont on parle ici, c’est donc d’une identification politique qui ne recouvre pas, n’annule pas, les autres modes d’identification, mais s’ajoute à eux. C’est aussi ce qu’ont pu nous apprendre Badiou ou Rancière : il faut passer d’une logique de la négation à une logique du supplément. Une identification nouvelle s’ajoute aux précédentes sans les nier.
En retour, bien sûr, elle ne les laisse pas inchangées. Jusqu’à quel point, c’est sans doute ce qui ne peut être théorisé à l’avance. Le double risque d’une supplémentation écrasante et d’une supplémentation évanescente ne peut être d’emblée conjurer, il est toujours présent dans le travail politique, et il n’existe pas de théorie qui garantirait a priori que nous avons trouvé le bon dosage.
Bernard Aspe, Lachaud, 27 août 2020
———————————————-
Bernard Aspe est l’un des animateurs du Séminaire Paradigmes de la division politique qui est accueilli à La Parole errante depuis trois ans.
Sur la situation dans la pandémie, il vient de publier Crime d’État, dans Terrestres, revue des livres, des idées et des écologies.
On peut également lire en ligne divers textes dont il est l’auteur, dont celui d’un livre publié en 2010, L’instant d’après. Projectiles pour une politique à l’état naissant, sur une page qui indique par ailleurs un ensemble d’écrits de Bernard Aspe eux-aussi disponibles en ligne.
Le livre Ouvriers et capital, de Mario Tronti, cité par cet article, a été (re)publié par les éditions Entremonde (pdf en ligne).


