« Gestion pandémique : entre réaction à outrance et négligence ordinaire »
Séance 2 du séminaire « Scènes de la division politique »
Mardi 17 novembre 2020
Par Adrien T.
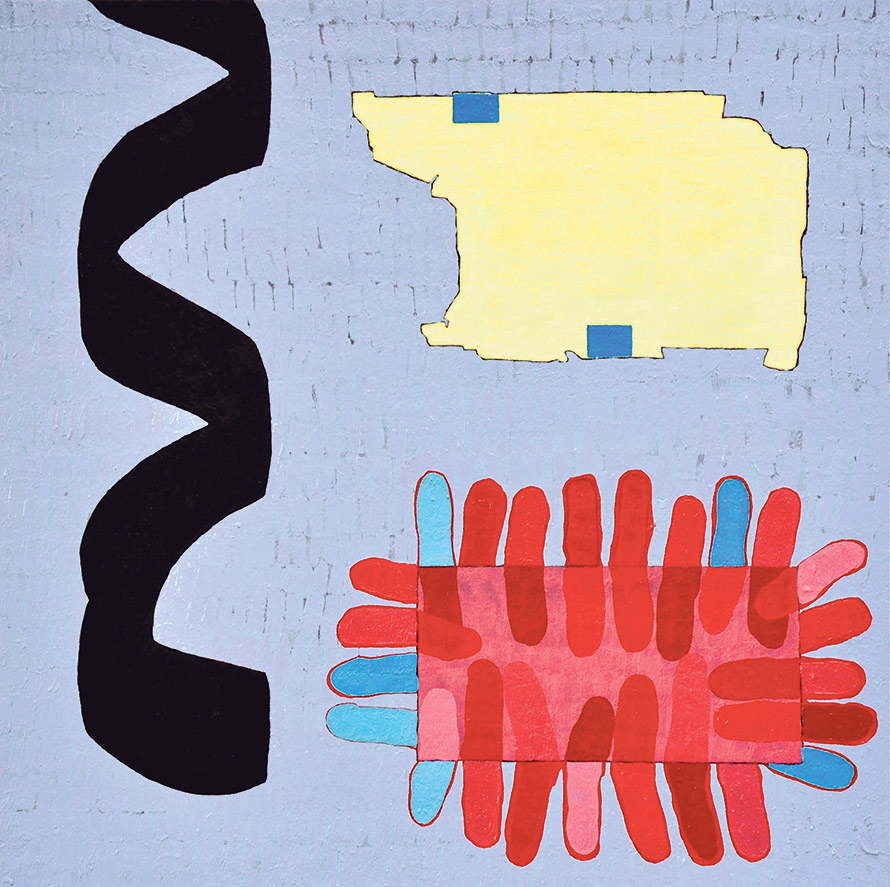
En mars 2020, l’économie mondiale a soudainement basculé de la coordination par le marché et la liberté individuelle d’entreprendre à des formes d’économie centralisée, et planifiée. Comme le décrit Mario Tronti à propos d’autres époques, lors de moments de crise, l’État se constitue en « capitaliste collectif idéel » contre les initiatives des capitalistes individuels et détermine les réorganisations et restructurations du système productif. La période du confinement a été cette période de temps pris par la classe capitaliste pour réorganiser la situation afin de relancer l’économie tout en composant avec l’incertitude radicale provoquée par le coronavirus de la COVID-19, inconnu jusqu’alors. C’était sidérant. « Chaque soir on lisait les chiffres de morts comme on lit un bulletin de guerres »[2]. La situation a été effrayante et l’est encore, quoique bien différemment. La menace d’une infection par les particules virales invisibles était partout en mars. Elle nous était également imposée par le vocabulaire guerrier, l’interruption du confinement au nom de la vie de chacun, « quoiqu’il en coûte » (a dit Macron à l’époque).
Nous aimerions dans une première partie proposer une entente possible des deux périodes de confinements, puis revenir dans une seconde partie sur les logiques de gouvernements et les réactions que cela suscite et provoque. Nous souhaitons proposer quelques mises au point à discuter, tout en sachant que face à l’ampleur de ce qui a été vécu, dit, fait, et face à l’ampleur des conséquences à venir à court et long terme, la pandémie est en partie irréductible et insaisissable pour l’analyse, voire pour la pensée. Nous devons préciser que nous ne sommes pas certains nous-mêmes de ce qu’il faut penser.
Nous nous demandons ce par quoi nous avons été contraints. Quelles sont quelques unes des limites et logiques qui ont participé à provoquer l’enchainement des restrictions et à nous plonger dans la situation présente ? Comment les états-nations, capitalistes collectifs idéels qui ont cherché à rétablir leurs prises sur la situation, ont-ils fait avec ces contraintes ?
La première partie porte donc plus sur l’infrastructure logistique, la seconde sur les divisions que suscitent et favorisent les rapports de pouvoirs actuels.
Révolution logistique
Nous commençons donc par un détour sur le capitalisme actuel, et sa logistique en particulier.
La mondialisation a plusieurs siècles, mais sur le type de globalisation dans laquelle nous sommes toutes et tous plongé-es, il est possible de constater au moins deux choses : les circuits du capital se croisent d’une façon ou d’une autre à une vitesse et un volume d’échanges gigantesque et l’ensemble de l’économie mondiale est d’une grande fragilité à court terme (la dépendance à certaines usines productrices de masques, de matériels médicaux ou de caoutchouc et autres peut peser sur l’ensemble des économies occidentales, les compagnies aériennes peuvent s’écrouler d’un jour à l’autre). Sans y chercher une explication finale, en dernière instance, on peut revenir sur la révolution logistique du capitalisme (je m’appuie ici sur la lecture qu’en fait Jasper Bernes, d’End Notes[3]).
Depuis les années 80-90, la production économique est organisée à flux tendu et sur le principe du juste à temps. Concrètement, chaque entreprise cherche à privilégier au stockage les flux continus de marchandises. Ce qui ne bouge pas équivaut à une perte de profits potentiels. Le principe logistique soumet toute marchandise produite aux conditions de sa mise en circulation. Si, par contraste, il pouvait s’agir autrefois de produire un certain volume de marchandises que les circuits de vente avaient ensuite à charge d’écouler sur le marché, il s’agit plutôt désormais de vendre ce qui est en cours de production ou vient tout juste d’être demandé. Le déploiement de la 5G dans les usines devant par exemple accélérer la possibilité de reconfigurer la chaine de montage et en bout de ligne les marchandises produites. Le terme de logistique désigne en ce sens le pouvoir de coordonner et de chorégraphier, de joindre ou disjoindre les circuits du capital, de les accélérer ou les ralentir. L’enjeu est de pouvoir changer le type de marchandises produites, son origine et sa destination, de collecter et distribuer les connaissances et savoirs de la chaine de production, des mouvements et des ventes de marchandises à travers le réseau. Dans l’idéal type du monde logistique, l’usine devient un moment du flux continu.
La révolution logistique cherche à transformer tout capital fixe en capital circulant. Cela reste impossible, puisque tout processus de valorisation s’appuie en définitive sur des formes de capital fixe, non liquides, bref sur des machines et des fabriques. Mais la logistique diminue ce risque, elle transforme toute technique de production en mode de circulation. Les fréquences et les circuits de circulation de marchandises comptent plus que les techniques de production. Ces trente dernières années, le capitalisme s’est profondément transformé et à chercher à multiplier et étendre les possibilités de profits rapides (contre la crise) par la financiarisation d’un côté, et en accentuant la circulation des marchandises à toute vitesse de l’autre : par les containers, les grands ports, l’automatisation robotique, les centres de distribution, et la révolution digitale et numérique pour coordonner l’ensemble. Tout a été fait pour réduire les coûts de circulation des marchandises. Cette extension des échanges a permis de mettre en concurrence n’importe quel ouvrier avec un autre situé à l’autre bout du monde, et a nécessité une coordination informatisée toujours plus grande. Ce cadre implique d’ailleurs une certaine division du travail, que l’on peut séparer très schématiquement ici entre manutention (ceux qui déplacent les cartons, livrent les marchandises, etc.) et coordination des flux (ceux qui décident à l’aide d’algorithme, ceux qui gèrent et peuvent plus facilement basculer en télétravail).
Il nous semble que cette arrière fond a été particulièrement visible ces derniers mois, y compris dans son moment de diminution radicale en mars et avril. Même diminuée, la circulation des marchandises devait continuer, et la production s’adapter au nouveau contexte (je pense ici aux usines automobiles qui ont révisé leur chaine de fabrication pour produire des respirateurs artificiels et/ou des masques). La révolution logistique ne relève pas seulement d’une accélération quantitative, un surplus de vitesse mais une certaine logique de structuration de la production et l’économie.
Surcharge au printemps
Je reviens donc au sujet qui nous intéresse, la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Depuis mars 2020, il n’a pas été question d’augmenter les lits de réanimation, ou de renforcer les infrastructures hospitalières. Macron l’a dit explicitement, « ce n’est pas une question de budgets mais d’organisation ». Il faut accélérer les choses, parvenir à du flux tendu, continuer de faire payer à la tâche, à l’activité et maintenir une circulation rapide des lits d’hôpitaux. En septembre 2019, quelques mois avant la crise, « on instaurait par exemple des bed managers chargés de « lisser les flux d’entrée et de sortie des patients dans les différents services » [4]. A l’hôpital Saint-Antoine de Paris, par exemple, des secteurs ont été transformés en accueil destiné aux malades du COVID, pendant tout le premier confinement, comme dans beaucoup d’autres hôpitaux pour doubler les capacités d’accueil le temps de surcharge déterminé par le confinement. En ce sens, le confinement du printemps a finalement moins contredit cette logique qu’il ne l’a confirmé.
En grande partie, nous avons été confinés faute de moyens pour nous soigner, ou faute d’anticipation pour prévenir ce genre de situations, ou pour aujourd’hui réduire la reprise virale d’octobre-novembre (alors même que toutes les modélisations l’anticipaient dès février 2020 au moins). Il fallait arrêter les circulations pour éviter une surcharge tout en ne changeant rien au circuit hospitalier ou aux infrastructures de réanimation. Les masques manquaient, ainsi que les principes actifs. Partout, les moyens semblaient limités, parce qu’il était impossible que tous les pays se fournissent aux mêmes endroits au même moment. Chaque nation a toutefois essayé de prendre le contrôle sur les circuits. La circulation logistique déjà très fragile en temps normal n’était pas en mesure de s’adapter immédiatement à l’arrivée du virus. Ce d’autant plus, on l’a dit, que cela a ouvert une période de concurrence terrible entre différentes nations, avec vols périodiques des cargaisons. L’arrêt temporaire a été une soupape de sécurité pour limiter momentanément la surcharge autant que l’impossibilité de se fournir. En ce sens, cela continue d’être une adaptation à flux tendu. Les dispositifs de chômage partiel sont une autre manière d’immobiliser un temps la force de travail, de la maintenir en réserve avant la reprise, là encore le temps d’un arrêt momentané. On joue avec les contraintes sans rien changer. Chaque mesure maintient le statu-quo. Aujourd’hui, les aides financières aux entreprises garantissent les emprunts et retardent les échéances. Ces aides maintiennent à flot mais il est probable que de nombreuses faillites s’en suivent dans les années à venir.
L’autorité de l’État dans l’incertitude radicale
De la rumeur d’une épidémie en cours, de la soirée de Macron au théâtre affirmant l’inquiétude inutile, le quotidien de toute la France et de beaucoup de pays d’Europe a soudainement basculé avec l’annonce des mesures de confinement en mars. Du jour au lendemain, la menace du virus a fait autorité et tout a été bouleversé. La parole du chef d’état, notamment par l’usage de la rhétorique de la guerre a eu de fait beaucoup de poids. La peur a été immédiatement présente, on le remarque d’autant plus que la réaction lors du début du deuxième confinement a été et reste très différente. En mars, chaque entité économique nationale s’est forgée un jugement pour savoir si la crise sanitaire serait brève et donc peu coûteuse, ou longue et dramatique. Disons que chaque acteur regarde ce que l’autre fait pour l’imiter, dans un dilemme du prisonnier revisité. En mars, tous ont pris pour acquis les avis du Royal Imperial College de Londres (ils ont pris l’avis d’une ex-puissance impériale, avec une certaine « autorité » donc). Dans l’incertitude, il est moins risqué d’adopter la même référence. Pour chaque gouvernement, la durée des restrictions à la mobilité doit correspondre au moment où la valeur des vies humaines épargnées est égale à la perte de revenu dans l’économie (à la baisse du PIB). Aucun système politique n’a en ceci quitté la sphère des opérations de calculs. Il n’y a pas d’entrée dans la démesure, si ce n’est celle calculée du volume des plans de relances et des dettes.
D’une certaine façon, comme le dit l’anthropologue Frédéric Keck, « le nombre de morts d’une maladie infectieuse émergente est devenu un indicateur des performances nationales autant que les points de croissance économique, les résultats sportifs ou l’espérance de vie[5] ». La discussion portait sur la mise en concurrence des capacités hospitalières nationales. La critique s’est concentrée dès lors sur les infrastructures et le manque ou l’absence de moyens. La rhétorique, on l’a dit, était guerrière et comme l’a dit le 21 mars Geoffroy de Bézieux le directeur du MEDEF “Nous devons aller vers une forme d’union sacrée”. Dans beaucoup d’hôpitaux, les internes racontent s’être mobilisés, entièrement pris par la situation et l’urgence bien réelle des malades[6]. L’union sacrée a tenu par l’urgence et la mobilisation permanente des soignants.
Pour contenir l’épidémie, il aurait fallu que la Chine bloque 60 à 70% des infections. Malgré l’avalanche des moyens de confinement déployés en Chine et du degré de coercition qui a entouré les malades ou les villes susceptibles d’être exposé au virus, cela n’a pas fonctionné. La Chine, comme en fait l’hypothèse Fréderic Keck, a alors envoyé un défi, une épreuve au reste du monde, en servant de modèle repère quand à l’étendue des mesures à prendre. On doit ici rappeler la grande part d’incertitude courant janvier, février, sur la mortalité potentielle du virus, sur ses modes d’infections et les conséquences de la maladie. Les modélisations effectuées, y compris celle de Londres ont envisagé différents scénarios, en se basant sur les coronavirus précédents. Ces modélisations ne peuvent toutefois pas prendre en compte les effets des changements de comportements, si ce n’est de manière marginale. Les effets du confinement, des distances entre les personnes, etc, sont en partie immesurables. Ils ne le sont qu’après coup. Par exemple, en France et sans doute ailleurs, il a été décidé d’interrompre en mars les services de procréation médicalement assistée. Car à ce moment là, il n’y avait aucune certitude sur l’effet du COVID sur les grossesses. Par précaution, ils ont préféré tout interrompre. Il reste difficile de rejeter unilatéralement ce principe de précaution.
Philippe Pignarre évoque (dans la revue « comment faire » éditée au Seuil depuis juin dernier[7]) la distinction entre science déjà faîte et science en train de se faire. Les pouvoirs politiques n’ont mobilisé la science que pour justifier leurs décisions, comme des arguments d’autorité. Cette représentation de la vérité servant alors de fait indiscutable et la science de méthode pour dire ce qui est afin de taire la discussion. En pratique, les sciences ne font rien taire du tout, elles multiplient les controverses. Particulièrement sur les virus, il est impossible de suivre une vision progressiste selon laquelle on accumulerait au fil du temps des connaissances pour finalement encadrer le virus. Ce dernier est en constante évolution, mutation, son comportement et les réactions peuvent changer, de sorte que le temps qui passe n’apporte pas une progression linéaire.
En mars, au départ, la grande incertitude sur le virus et ses effets possibles a entrainé une stratégie de précaution, de dernière minute. Tellement tardive, qu’elle relève de la logique dite de préparation qui prédomine, depuis les attentas du 11 septembre 2001 au moins, la gestion des attaques terroristes comme des émergences virales. Il faut être toujours déjà prêts, comme si la catastrophe était déjà là et agir en conséquence. C’est une logique paradoxale, la préparation ne peut pas empêcher les pandémies, simplement nous préparer à agir dans la catastrophe avec une avalanche de moyens, mais en amont rien ou presque, on est déjà dedans.
Je me permets un rapide détour pour rappeler que ce n’est pas la première fois que le principe de précaution est appliqué. Je ne citerais que deux exemples. En 2009, en France, plus d’1,7 milliards de masques avaient été commandé ainsi que des dizaines de millions de doses de vaccin dans la crainte d’une épidémie du virus de la grippe H1N1. Ils n’avaient servi à rien, l’épidémie ayant finalement été de courte durée. En mars 2014 quand le virus Ebola ressurgit au Sierra Leone, il fait très peur. Une mobilisation internationale s’en suit rapidement et en septembre 2014, une projection américaine prévoit en une du journal du Times 1,4 millions de cas dans les 6 mois. L’épidémie sera finalement vite contrôlée, au sens où elle ne quittera que très peu la Guinée, le Sierra Leone et le Liberia. Cela étant, les États-Unis sous Obama avaient déployé 3000 milliards et 20 hôpitaux de campagnes au Sierra Leone, pour traiter finalement 28 patients en tout. La moitié des 20 hôpitaux n’ont jamais vu aucun patient. Finalement, en janvier 2015, il y aura eu 28 000 cas et 11 000 morts d’Ebola, dont 99,99% en Afrique[8]. L’opération américaine a été une précaution inutile, la maladie n’a eu qu’une extension locale. Il semble toutefois présomptueux de dire que rien n’a été fait ou que cela fut fait pour rien. ll y aurait par contre beaucoup à dire évidemment sur les modalités d’une telle intervention.
J’aimerais revenir un instant sur le confinement et plus précisément sur le problème, largement souligné, de la définition du service essentiel. Qu’est-ce qu’un service essentiel ? Qu’est-ce qui, en dépit du danger, a été considéré comme vital ? Ce qui est essentiel, nous l’avons vu plus haut, ce n’est pas tant la production, mais les circuits de circulation du capital. Lors des deux confinements, une distinction assez précise s’établit entre deux formes de travail, deux catégories de travailleurs : ceux qui sont exposés et ceux qui télétravaillent. Cette division recoupe la partition dont nous avons parlé plus haut, entre, d’un côté, la manutention et, de l’autre, la coordination des flux du capital. L’essentiel est l’utile.
Avec le deuxième confinement, la même logique s’applique avec d’autant plus d’efficacité que toute la part de coordination était en partie préparée au télétravail pendant que la main d’œuvre immédiate de bout de chaine continuait de façon plus étendue encore à travailler. On ne peut ignorer ce basculement. D’une part, il témoigne du basculement que l’on observe avec le primat des plateformes numériques telles qu’amazon, deliveroo, etc. Le commerce semi-automatisé devient l’infrastructure de base. D’autre part, et surtout, le travail prime. La vie culturelle est interdite mais pas le travail. En mars, rester chez soi était une nécessité absolue pour se protéger du virus et éviter de le répandre. Mais en octobre il s’agit avant tout de maintenir l’économie en continuant à travailler à tout prix et ne rentrer chez soi que seul et avec interdiction si ce n’est crainte d’y faire quoique ce soit qui puisse être contaminant. Si l’on en croit les ministres, tout s’est renversé. Chaque ministre concerné l’a précisé, on ne se contamine pas dans les transports, on ne se contamine pas à l’école, on ne se contamine pas dans l’entreprise (quelle hécatombe que le confinement du printemps alors!).
Des infrastructures à la responsabilité individuelle
Nous pouvons donc observer deux moments distincts dans les stratégies de communication du pouvoir, du moins en France et sans doute en Europe également. Dans un premier temps, en mars, l’attention était dirigée sur les États, la manière dont ils étaient ou non préparés, et plus précisément sur leurs infrastructures sanitaires. On se rappelle les corrélations entre le nombre de lits et de réanimateurs disponibles et le nombre de morts, visibles dans la comparaison entre la France et l’Allemagne par exemple. Dans ce premier moment, la responsabilité est donc du côté des infrastructures de l’État. C’est d’ailleurs pourquoi les grandes puissances se renvoient la balle des responsabilités, s’empressant d’accuser la Chine. Dans cette première période, il semble que pendant des mois la logique assurantielle domine. Personne ne veut prendre la responsabilité, assumer telle ou telle décision et pouvoir être ensuite mis en cause, éventuellement au tribunal. En mai, il y a eu de nombreuses tensions sur le partage des responsabilités entre État et mairie au moment du déconfinement.
Pendant l’été, il s’est clairement agi pour le pouvoir de déplacer l’attention des infrastructures vers les comportements individuels. Macron fin mai célébrait dans les journaux « le retour des jours heureux » avec la réouverture des bars et des restaurants, invitant à sortir et consommer. C’était pour mieux préparer le terrain au fait que « les gens n’allaient » pas être à la hauteur. Paris Match publie le 8 août un article à propos des fêtes sur la Côte d’Azur qui résume le tube journalistique de l’été « Tout le long de la journée, jusqu’au coucher du soleil, les verres s’échangent, les corps se collent, les salives se partagent. On oublie vite que le vin ou la bière ne sont pas des vaccins et que le coronavirus n’a pas pris de vacances. » Les bulletins France Info multiplient avec plus ou moins de retenue le même genre de messages et toute la rentrée étudiante, plutôt que d’interroger l’aération ou la ventilation des bâtiments, ils font témoigner des jeunes qui continuent de festoyer dans des appartements aussitôt les bars fermés. Le 12 août le journal le Monde titre : « Coronavirus : face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement appelle les Français à « se ressaisir ». Tout l’été Jean Castex en appelle à la responsabilité de chacun. « Je l’ai dit à plusieurs reprises, une société démocratique moderne ne peut pas tout attendre de l’Etat et des collectivités locales. Chacun détient et exerce une part de responsabilité. »
Crise exogène devenue endogène
Aujourd’hui, nous faisons tous l’expérience de cette étrange normalisation de la situation que favorise la responsabilisation individuelle. Bien qu’il n’y ait plus de normalité à laquelle se référer, nous devons continuer de travailler tout en acceptant l’idée qu’on se contamine chez nous ou avec nos amis. L’arrivée du virus a pris au départ des allures de crise exogène, avec l’entrée d’un indésirable par l’extérieur. Aujourd’hui, la crise est devenue endogène. Le virus est parmi nous, c’est l’ennemi intérieur et il faut vivre avec. La menace n’est plus le dehors et le travail mais le foyer et nos proches.
La décision de reconfiner a été plus contestée, même sur la scène parlementaire l’union sacrée de mars est bien plus fragile. La maitrise étatique de l’économie est disputée, les petits commerçants prennent au mot le gouvernement, « puisque nous savons appliquer les gestes barrières et les protocoles sanitaires nous devrions pouvoir rouvrir » disent-ils. Ces divisions n’excluent pas la possibilité de blâmer certains comportements ou certains individus plutôt que d’autres. Les tensions raciales sont de fait explosives depuis mai, on y reviendra.
En France, à terme, il est possible qu’une forme de lassitude et de découragement risque de prédominer, de sorte qu’à force de subir les incohérences des décisions politiques tout un chacun préfère envoyer tout valser. C’est d’autant plus justifiable que nous nous trouvons condamnés à l’enfer logistique des files d’attentes et des surcharges hospitalières, comme si nous en demandions tous et toutes trop. Le gouverneur du Texas avait proclamé en mars que si on lui demandait : « Êtes-vous d’accord pour prendre un risque pour votre survie en échange de la préservation, pour vos enfants et petits-enfants, de l’Amérique telle que toute l’Amérique l’aime ? » Il accepterait immédiatement de façon à sauver l’économie et il ajoutait que tel était le choix que toute personne âgée devrait faire »[9]. Formulé ainsi, la question a tout le cynisme de l’économie et des puissants, mais le temps passant on peut se demander si ce n’est pas le choix qui nous est peu à peu imposé.
La politique de responsabilisation individuelle inverse la causalité. On ne tombe plus malade à cause de l’arrivée d’un nouveau virus mais de n’avoir personnellement pas suivi les comportements prescrits. C’est à nous de tout faire pour prouver qu’on fait ce qu’il faut pour répondre à l’infection ou alors on rejoint les fautifs. Un peu comme avec la CAF, l’aide que l’on reçoit n’a rien d’un droit, c’est une concession qui nous endette auprès d’une institution qui fait tout pour nous aider, mais la solliciter témoigne de notre échec individuel. Nous n’avons pas été assez performants, assez forts. Malade, on est avant tout suspecté d’avoir fraudé et festoyé en dehors du travail avec des cas contacts.
Ces discours servent avant tout à définir la norme, et s’adressent à tous ceux et celles qui ne sont pas directement concernés pour installer un partage généralisé entre bons et mauvais malades. Depuis peu, des directeurs d’établissements scolaires ne voulaient pas déclarer des cas identifiés dans leur établissement pour pouvoir maintenir les lieux ouverts. Aujourd’hui, alors même que nous sommes officiellement confinés, il n’est pas si évident de savoir comment agir si l’on pense être infecté. En mars, on nous martelait de rester chez nous en cas de doute ou suspicion, aujourd’hui il n’est pas toujours simple de ne pas aller travailler sans avoir un résultat de test positif. Je me permets ce bref rappel parce que la république française mobilise une culpabilisation individuelle qui lui est bien spécifique. On pourra y revenir dans la discussion. Le système singulier des attestations pour pouvoir circuler est typiquement français, et inexistant ailleurs. Certains pays appliquent le suivi des smartphone, au moins la surveillance est explicite. L’attestation c’est autre chose, nous devons être responsables tout en justifiant nos actions. Dès lors, chacun mesure ce qu’il peut faire moins en fonction du virus que des chances de recevoir une amende. Nous sommes traités comme des incapables en manque d’autorité pour dicter les règles. C’est d’ailleurs une certitude pour n’importe quel politologue[10] plus les réglementations se multiplient, plus il y a nécessairement de la défiance et des incitations à tricher.
C’est une question éminemment biopolitique, mais avant d’y venir et de commencer notre deuxième partie sur la façon dont ce pouvoir exerce son emprise aujourd’hui, il nous semble nécessaire de préciser la nécessité de percevoir ce qui nous arrive indépendamment des mesures de restriction.
Percevoir ce qui arrive
L’ouvrage « Fukushima et ses invisibles[11] » insiste sur le fait que « La catastrophe nucléaire de Fukushima atteint indissociablement la composition du monde et la manière dont on en fait l’expérience »[12]. L’accident de Fukushima a provoqué des doutes sur la réalité des particules radioactives, la façon dont elles circulent, l’étendue des dangers. Les autorités minimisaient beaucoup la catastrophe et reprenait le mot d’ordre bien éprouvé après Tchernobyl, « les angoisses à propos des radiations vous rendent plus malades que les radiations ». Une telle catastrophe fait douter de la réalité de la réalité. Les invisibles particules nucléaires, auparavant cloisonnées par les sciences expérimentales au sein des laboratoires et des réacteurs, se mettent à hanter toute la société, tous les esprits et tous les corps. De plus, plusieurs textes du livre insistent sur les rumeurs, les bruits qui courent. La peur frôle certes souvent la paranoïa, ce d’autant plus que dans le cas d’une catastrophe nucléaire les autorités affirment que tout va bien et s’efforcent de tout faire oublier par la relance perpétuelle de l’économie. Pour autant, avoir peur continue de compter. Comme le dit Mari Matsumoto, l’autrice d’un des textes:
L’ultime potentialité d’émancipation, sinon de guérison, je la vois (…) dans les rumeurs et la panique diffuse, dans la puissance fondamentale de la terreur, nourries par l’effroi et la rage du monde. Cette puissance initie nos pensées à ce qui est réellement émouvant, fragile et précaire. C’est-à-dire à la seule assise de résistance au statu quo, dans lequel l’expansion sans fin de l’accident risque d’être absorbée. Comme l’affirme Yu-Fu Tuan dans son livre Landscape of Fear (un paysage de peur), une communauté qui perd sa capacité à ressentir la peur va périr[13].
La peur comme les rumeurs font partie des réactions face à toutes les catastrophes, de l’incendie de Lubrizol au virus du COVID-19. Dans la catastrophe, rien n’établit avec certitude la composition du réel. Mari Matsumoto invite à ne pas mépriser la peur, comme si elle témoignait forcément d’une perte du sens de la raison, ou d’une foule incapable de se gouverner vouée à l’être par d’autres. Les critiques de la peur parlent souvent comme si elles pouvaient énoncer ce qu’il faudrait faire et penser, quelle serait la bonne manière d’agir. La peur évidemment peut tourner à la panique du chacun pour soi, la rumeur à des formes de complotisme (le complot comme le dit Frederic Jameson est souvent « la cartographie cognitive du pauvre ») mais les deux participent pour autant des manières de se représenter ce qui est en train d’arriver, d’établir une perception de l’état de la réalité. La profusion de collectifs de mesure équipés de compteur geiger après Fukushima a été, un temps, un des moyens d’établir indépendamment des discours du gouvernement et de TEPCO la réalité radioactive de la situation. Évidemment, il n’existe pas de tels compteurs pour mesurer les particules virales, en dehors d’un laboratoire (et encore). Le virus est en somme visible par ses symptômes, par un test plus ou moins fiable (selon le moment où il est effectué). Trop souvent sans doute, il n’est visible que par le nombre de malades et de morts qu’il provoque (morts qui peuvent être lointains dès qu’ils ne touchent pas des proches). L’écart entre cette visibilité statistique et l’invisibilité du virus, son caractère insaisissable à moins de l’attraper peut susciter bien des interprétations, qu’il s’agirait parfois de ne pas combler trop vite.
Pour prendre un exemple, dans un tract gallimard récent, deux énarques (Renaud Girard et Jean-Loup Bonamy) affirment « ce n’est pas la Covid-19 qui a mis le monde à terre, mais la psychose provoquée par le virus[14]« . L’ensemble du texte s’applique ensuite à affirmer que les réactions ont été complètement absurdes, disproportionnées, que ce n’était qu’un problème d’organisation qui aurait dû se traduire par une politique de prise en charge des plus vulnérables, de soins et de mesures ciblées, bref « le bon sens » disent-ils. Selon eux, « en 2020, la COVID, à elle seule, ne fera pas bouger le chiffre de la mortalité mondiale[15] (…) », le remède est selon nos auteurs pire que le mal (Trump l’avait dit). Il y a bien des causes plus graves de mortalité. Ils laissent aussi apparaître à d’autres moments du texte leur sens de la morale pour sauver le travail : « des métallurgistes italiens firent grève, pour avoir le droit de cesser le travail et de se confiner, alors qu’ils sont dans un métier aujourd’hui mécanisé, souvent robotisé, où il n’est pas difficile de garder des distances de sécurité entre employés[16] », ou encore « chez Amazon-France, des employés obtinrent de la justice que les entrepôts de l’entreprise soient fermés au motif d’une « mise en danger de la vie d’autrui », sans même se soucier des PME et des logisticiens qui risquaient de faire faillite à cause de cette décision ». Ils affirment également que si la peur n’avait pas pris les français en juin 1940, nous aurions pu nous ressaisir et empêcher la grande débâcle face aux allemands… Outre ces auteurs, depuis des mois, certains mettent en rapport les morts de la route ou du diabète avec la mortalité de la COVID-19, pour minimiser l’impact du virus. Poser le problème ainsi nous semble une impasse, peu importe quelque part ce que disent ou non les chiffres. La médecine clinique se définit comme le rapport entre un patient et un médecin, dans un rapport de soin de personne à personne. La santé publique concerne les populations, et de toutes autres échelles, mais l’on ne bascule pas de l’une à l’autre l’air de rien armé de son seul bon sens, ou en internalisant la perception statistique Nous avons besoin d’autres manières de nous rendre visible et perceptible la présence ou l’absence du virus.
Nous ne voulons donc pas discuter ici des affirmations de psychoses ou des statistiques employées mais affirmer par contre notre ignorance. Il est impossible de perdre cette incertitude sur ce qu’aurait pu être la pandémie sans le confinement du printemps, ni sur ce qu’il va se passer. Le virus est là encore irréductible à toute saisie totalisante et définitive. Il nous semble impossible de penser l’entièreté de la situation mondiale en prétendant savoir ce qui aurait ou devrait être fait, comme si l’on pouvait basculer de notre échelle à la totalité du monde en toute connaissance de cause. Cela revient à adopter un point de vue de nulle part, une énonciation qui parle en surplomb sur un ensemble de situations. Comparer les causes des mortalités, pour en établir un barème a peu de sens. Même à l’échelle de la France, comment affirmer que cela s’est passé ainsi dans tous les hôpitaux, tous les EHPAD, tous les lieux de vies et de soins ? Dans certains EHPAD, les contaminations et les morts ont été très nombreuses. Dans d’autres EHPAD, le COVID a peu frappé. Dans un très bon entretien paru sur ACTA en avril[17], Laurent, un cadre de santé dans un EHPAD du 93 raconte comment malgré les interdictions ils ont maintenu les visites, la circulation au sein de l’EHPAD et même laissé sortir les résidents pour qu’ils constatent le confinement général, qu’ils voient ce qui se passait pour tout le monde. Toutes ces petites fraudes ont demandé bien plus de travail aux soignants, mais l’ambiance, la confiance, la discussion, le maintien de la possibilité de bonnes conditions de travail et de rapports de soins a évité la circulation du virus pendant le premier confinement. Ni le soin ni l’éthique n’ont disparu. Dans d’autres EHPAD, quand le travail est impossible, les rapports hiérarchiques nocifs, la situation a pu être catastrophique. Dans leur tract, Girard et Bonnamy disent seulement « on a enfermé ensemble des malades et des non-malades, facilitant ainsi parfois la propagation du virus. C’est ce qu’on a constaté dans les EHPAD ». Ils n’énoncent qu’un rapport gestionnaire dont ils auraient la clé.
Biopolitique
S’il reste indéniable que nous avons été et sommes aujourd’hui gérés, jusque dans nos comportements quotidiens, il nous semble nécessaire de revenir sur les modalités dont les pouvoirs biopolitiques agissent. Comme l’a rappelé Bernard Aspe lors de la séance précédente, le tissu biopolitique en tant que « condition d’opérativité des forces mises au travail » est l’objet de la gouvernementalité libérale, « qui trouve ses prises sur les individus et sur les populations. La gestion biopolitique se démarque du pouvoir disciplinaire, selon Foucault, parce qu’il s’agit (je reprends ici l’intervention du mois dernier de Bernard) « d’intervenir le moins possible sur les échanges économiques en tant que tels ». « Il est essentiel que les relations sociales et les compétences particulières qu’elles demandent, se développent en quelque sorte « pour elles-mêmes ». « C’est en ce sens, Foucault insiste sur ce point, que le libéralisme n’est pas une idéologie, (…) mais bien un art de gouverner qui a besoin de solliciter la liberté réelle des individus.[18] »
Notre questionnement porte sur la façon dont opère ce pouvoir biopolitique, et on peut repartir de la définition que donne, après Foucault, la philosophe Judith Butler de la biopolitique:
« Par biopolitique, j’entends ces pouvoirs qui organisent notre vie, ainsi que ceux qui rendent certaines vies plus précaires que d’autres, qui relèvent plus largement d’une gestion gouvernementale ou non des populations, et qui prennent des séries de mesures pour l’évaluation différenciée de la vie elle-même. « [19]
La gestion biopolitique n’agit pas uniformément, elle se fonde sur la hiérarchisation des valeurs de la vie, et produit différentes précarités. Pour Butler, le sujet de la biopolitique est moins le sujet vulnérable que le sujet précaire. Le sujet vulnérable est exposé aux blessures, alors que, de son côté, « le sujet précaire » est celui qui doit prier constamment pour qu’on lui concède des droits, du travail, un logement. Judith Butler insiste, la biopolitique nous interpelle moins par son caractère englobant que par sa propension à produire des césures, des distinctions entre les vies. Cette production différenciée de la valeur des vies interroge selon elle ce que signifie « bien vivre ». À l’évidence, le sens d’une vie bonne ne saurait être seulement déterminé par les autorités ou leurs conseillers. La biopolitique c’est précisément cette forme de la politique qui plutôt que de délibérer sur les « formes » que prend la vie collective, se met à prendre pour objet la « vie » elle-même, indépendamment de sa forme, sans égard pour ce que ça peut vouloir dire de vivre et comment.
Didier Fassin dans sa leçon inaugurale au Collège de France sur « l’inégalité des vies », rappelle en écho à cette question la tension entre une certaine approche éthique qui confère une valeur absolue à la vie (par exemple la morale religieuse chrétienne) et l’approche économique, qui lui accorde une valeur relative (et il existe différents modes de calculs de la valeur d’une vie, en justice lors du calcul des préjudices, en assurance-vie, etc). Le principe de la valeur relative des vies tend à dominer les modes de gestion des populations et les politiques de santé publique.
Certaines notions ont été inventées pour mesurer cette valeur relative de la vie, telle que l’espérance de vie. L’espérance de vie est une mesure abstraite et quantitative, une statistique sur la probabilité de décéder aux différents âges (cette notion a commencé à se construire au XVIIe siècle par les tables de mortalité établi par John Graunt). Comme l’observe Fassin, elle ne dit rien de la vie qui peut être mené, de ce qui peut en être attendu, ou espéré. Je le cite: « il y a ainsi, d’un côté, la vie qui s’écoule avec un commencement et une fin, comme pour tout être vivant, et de l’autre, la vie qui fait la singularité humaine parce qu’elle se compose d’événements qui peuvent être racontés[20] » . Fassin observe ici que le mot « vie » désigne au moins deux choses très différentes : la vie biologique, celle qui est prise comme objet par la santé, et la vie « biographique », qui désigne la singularité de la trajectoire d’une personne particulière, son caractère et son histoire. Selon Fassin, « l’inégalité des vies ne peut être appréhendée que dans la reconnaissance des deux occurrences de la vie ». Toute la question tient au comment s’opère cette jonction. Dans l’histoire, selon Didier Fassin, chaque société a le taux de mortalité qui lui convient, le nombre de morts qui semble acceptable. On va y revenir.
Variations des expérimentations nationales
Les restrictions de mars ont déterminé les modalités d’existence de millions de personnes mais de façons localement différenciées. En mars, le gouvernement indien a décidé du jour au lendemain d’un confinement strict, envoyant des centaines de travailleurs sur les routes pour rentrer chez eux, sans anticipation aucunes. Le dirigeant des Philippines a annoncé que la police pourrait tirer sur les personnes qui ne respecteraient pas le confinement. Au Kenya, la police a gazé et brutalisé un grand nombre de personnes qui supposément ne respectaient pas le confinement. En Inde, le gouvernement a passé plusieurs lois qui suspendent certaines réglementations sur la santé au travail pour stimuler l’économie (au Canada, ce sont les législations environnementales ont été suspendu). En Suède, à l’inverse, rien n’a été restreint mais le gouvernement en a appelé à la précaution, aux gestes barrières et à l’autoconfinement des personnes vulnérables.
Ces différentes stratégies ont moins été choisies en fonction du virus ou d’arguments scientifiques que selon leur potentielle mise en œuvre pratique, et surtout en fonction des rapports à la population et la société civile. Chaque situation met en jeu un rapport au nombre acceptable de morts par la société. Aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, quand l’État sait ne pas avoir les moyens de soigner la population, il décide de ne rien faire dans une forme de néolibéralisme épidémiologique prêt à sacrifier une partie défavorisée de la population pour mieux soutenir une alliance politique bâtie sur la liberté individuelle et l’esprit d’entreprise afin de susciter un rapide retour à la croissance. Le critère économique prime. Le président Bolsonaro déclarait en mars (devançant tout ceux qui calculent les morts de la route pour minimiser le virus) : « certains vont mourir ? Oui, bien sûr. J’en suis désolé, mais c’est la vie. On ne peut pas arrêter une usine de voitures parce qu’il y a des morts sur la route chaque année[21] ». En France, et en Europe, il a été tenté un compromis pour casser les chaines de contamination. Accepter de sacrifier la production d’une partie des biens et services traditionnels pour minimiser les dégâts du COVID sur la santé, tant que ne tarde pas trop le contrôle de la pandémie. Ce compromis est autant logistique, économique, que biopolitique.
Le rapport à la population relève d’une forme de calcul autant que d’un rapport de force. Les gouvernements anticipent la confiance qui existe entre institutions et société civile, et donc sur la capacité d’auto-discipline présente dans la société. Cette évaluation n’est jamais complètement fausse. De fait en Suède par exemple, (nonobstant la communication qui décrit toujours les pays scandinaves comme des paradis de croissance libérale) la mesure des déplacements individuels de porteurs de smartphone montre une baisse de plus de 40% des déplacements. Cela témoigne d’une forme importante d’auto-confinement et les sorties récréatives ont beaucoup diminué (la baisse était de 60 à 70% en France en avril)[22]. Par contre, en Suède toujours, d’autres chiffres montrent une forte mortalité des personnes âgées, des prisonniers et des populations les plus pauvres, coût inévitable du néolibéralisme épidémiologique, quand la liberté individuelle du travail prime. À l’opposé, si le président des Philippines autorise la police à ouvrir le feu, c’est qu’il considère lui-même en partie sa population comme surnuméraire, sacrifiable, indigne. La gestion biopolitique s’est parfois révélée crûment, à l’échelle de chaque hôpital par les directives de santé publique. En mars, l’Alabama aux États-Unis a spécifié que les personnes souffrant d’handicaps mentaux ne seraient pas les premiers candidats choisis pour l’assistance respiratoire, et l’état du Tennessee a exclu des soins d’urgence les personnes souffrant de maladies d’atrophie musculaire nécessitant une assistance quotidienne. Des choix sont faits en fonction de ce que valent les vies.
La déflation de contrôle
Ce n’est pas même un plan, une décision, une stratégie des puissants pour se débarrasser des faibles. Il n’est pas pertinent de penser ces processus par les intentions ou les stratégies des acteurs. Même les puissants étaient désemparés, la question est plutôt celle de la possible maitrise de l’état d’exception, de qui maintient ou prend du pouvoir. Dans chaque pays, il y a eu et il y a encore des arbitrages entre raison sanitaire et raison économique. Certains états ont préféré ne rien faire. Boris Johnson et Trump ont finalement décidé d’agir une fois la pression devenue trop grande en interne. Le cas échéant, on a eu moins affaire à une radicalisation autoritaire des pouvoirs étatiques qu’à une déflation du contrôle. Comme le souligne les auteurs de « De Virus illustribus », « n’est-il pas flagrant que la forme adéquate de la crise de la valeur se donne simplement par une déflation de contrôle qui permet d’affronter le problème des superflus, non par une mise à mort, mais simplement par un « laisser mourir »? »[23]. « Non pas le gouvernement autoritaire, mais le gouvernement paresseux, imbécile et indifférent, prêt à livrer la population à la mort plutôt qu’à risquer une réduction minimale du PIB »[24].
À la fois, les États s’emploient à continuer de paraître les seuls maitres à bord « en affirmant l’absolue nécessité de la mise en place d’une discipline sécuritaire qui réactive leur pouvoir souverain[25] », à la fois les multiples contradictions des mesures qui se mettent en place témoignent du désarroi et de l’incapacité des gouvernements à agir dans la situation suscitée par le virus. Cette situation pourrait s’aggraver, la crise économique ne pouvant qu’aller en s’approfondissant à moins d’une relance incroyable de l’économie. Le collectif de « de virus illustribus » identifie d’ailleurs un paradoxe à venir. La crise a réaffirmé le primat du politique, et des états-nations comme acteurs centraux et prétendument seuls capable d’administrer le désastre, alors même que la crise de valorisation, la perte de croissance, détruit le fondement et la légitimité des institutions politiques. Les états ne peuvent s’affirmer qu’au prix d’un endettement généralisé. La sphère étatico-politique risque de devenir toujours plus dysfonctionnelle, « Tout repose sur la croyance des créanciers dans la capacité des états à rembourser plus tard leurs dettes, en ponctionnant in fine, via la fiscalité, une masse sociale de valeur nouvelle qui sera produite dans le futur »[26]. Il va y avoir, selon eux, des états faillis, incapable d’intervenir, si ce n’est par leur police. Sans ici pouvoir trancher, il est de fait certain que les rapports entre pouvoirs politiques de décision et les effets de crise économique vont avoir de nombreuses conséquences.
Ce qui nous constitue comme sujets de la biopolitique
Il nous importe d’insister sur ces différences de réactions étatiques, qu’on ne fait ici qu’évoquer rapidement, car en définitive nous avons peut-être toujours déjà perdu si les problèmes que pose la gestion biopolitique nous font choisir entre soumission ou insoumission aux dispositifs. La multiplication de législations et d’obligations tout autant que leur absence font partie des méthodes de gestion. Simplement dit, il n’y a pas des êtres libres contre ceux qui obéissent, ou ceux qui savent passer par delà leur peur de la mort face à ceux qui pris de panique se laissent aller au désir d’immunité. Cela peut sembler caricatural, dit aussi schématiquement, mais il nous semble nécessaire de prêter attention aux manières de nous figurer tant la menace du virus que ce qu’entrainent les manières d’y répondre.
Le pouvoir biopolitique ne s’exerce pas sur nos vies de l’extérieur mais est et a été constitutif de nos subjectivités depuis au moins 2 siècles. L’enjeu est de s’opposer aux modalités d’existence des sujets concernés par les mesures, ces sujets que nous sommes. Avant l’exception d’une loi, nous avons été constitués comme sujets sur lesquels des mesures biopolitiques peuvent s’exercer. En ce sens là encore, nous n’avons pas une meilleure gestion à proposer mais des manières de renforcer nos capacités de répondre. C’est à ce titre qu’il faut suivre Foucault jusqu’au bout de ses travaux, dans une « Ontologie critique de nous-mêmes », qui figure moins un grand refus, que les processus par lesquels on devient sujet de la biopolitique, docile en temps normal et pas seulement sous le régime de l’exception. En se concentrant sur l’extension des dispositifs de contrôle, des mécanismes de surveillance et des lois d’exception, on peut souvent rendre moins visible le fait que le pouvoir disciplinaire et biopolitique s’exerce de multiples façons, ce de manière diffuse, automatique, invisible, voire parfaitement ordinaire, y compris sur les milieux et les non-humains et que c’est cette étendue du pouvoir qu’il nous faut défaire et destituer.
Imposer un autre calendrier et de toutes autres manières de faire face et avec le virus n’implique donc pas de valider le gouvernement ou les discours de responsabilisations civiques qu’il multiplie à l’envie. Leurs contradictions, comme cela a été souligné lors de la séance précédente, ne sont pas les nôtres. Prendre acte du virus, des risques qu’il pose, pour en tirer des conduites cela ne relève pas de la biopolitique, ni d’une biopolitique populaire. Une biopolitique populaire est un non-sens. L’art des bonnes distances et des manières de se lier les uns aux autres[27] relève de questions éthiques. Il s’agit par contre de déplacer les choses, de ne pas reprendre les problèmes tels qu’on veut nous les poser. La centralité du nombre de lits en réanimation, ou des discours sur la nécessité de fermer les frontières, sont des manières de très mal poser la question du soin face au COVID. Rarement, par exemple, l’idéologie républicaine française du territoire national comme devant être soumis à des directives identiques a été plus absurde. Ils appliquent uniformément les mêmes mesures, interdisent l’accès aux forêts, aux bords de mer, comme pour maintenir la clarté de la loi. Lilian Ceballos et Thierry Thévenin[28] racontent, dans un entretien paru dans la revue terrestres sur les médecines terrestres, que l’association La Maison de l’Artemisia s’est vue interdire toutes recherches ou essais en hôpital sur les vertus potentielles de l’ambroise ou d’autres plantes. En France, selon ces auteurs, la politique du « ni faire ni laisser faire » prime. C’est un exemple parmi d’autres, et qui s’est répété pour les laboratoires vétérinaires, et pour beaucoup de médecins de ville, tantôt interdits de prescrire tantôt devant prendre en charge sans moyens des malades.
On ne peut que s’interroger du peu de réflexions sur comment organiser notre confinement, notre pratique de soins et notre défense à partir des formes-de-vie, et non en fonction de l’économie, ou du devoir abstrait de sauver la vie quoiqu’il en coûte. Entre temps, la relance économique avance en compagnie de l’idée que chacun peut passer entre les gouttes ou qu’à la façon de Trump et Bolsonaro ce n’est pas grand chose de l’avoir et d’oublier (en oubliant surtout les dizaines de médecins dont ils ont, eux, bénéficiés). On ne peut que s’étonner, alors que le virus circule déjà depuis janvier dernier, du peu de collectifs de patients et de prises sur le virus lui-même via les connaissances qu’on peut essayer d’en avoir. L’épidémiologue allemand Drosten insiste par exemple sur la nécessité cruciale de s’isoler avant le déclenchement des symptômes, quand malheureusement on est encore sûr de rien mais qu’on est contagieux[29]. Or, la possibilité de ne pas aller travailler avant d’être testé positif est rare. Le confinement actuel montre combien la liberté d’aller et venir n’a pas été abolie, mais conditionnée au travail, arraisonnée aux comportements déterminés comme adéquats. L’obligation des masques en permanence, l’interdiction d’aller en bord de mer, ou marcher en forêt (sauf pour les chasseurs) achève de rendre tout absurde. La contagion aérosol continue d’être peu comprise, voire même discuté. Dehors, seul en bord de mer ou en montagne, il reste évident qu’il est impossible de se contaminer. L’incohérence, l’absence de vérité commune, suscite négligence et déni plus qu’autre chose.
Le collectif « du côté de la science » autour du médecin Christian Lehman est relativement actif, publie régulièrement des informations, d’autres médecins également. Mais il y a pour l’instant peu de prises politiques autour du virus. Autour du virus du SIDA, l’intervention d’ACT-UP fut décisive en France, pour imposer une prise en charge des malades, sans attendre un hypothétique vaccin (qui n’existe d’ailleurs pas encore, ni pour le SIDA ni pour la COVID-19). Le confinement et la multiplicité des discours jouent avec notre perception de la réalité, pour que dans la confusion seule la parole de l’État continue de compter, et même critiquée, de rester centrale.
Dès lors que les critiques des mesures minimisent le virus, il semble que la compréhension du virus et sa contagion en devienne secondaire, ou négligeable, quitte à rejoindre l’hypothèse selon laquelle il serait devenu inoffensif ou qu’il suffit de le laisser circuler. C’est d’autant plus étrange que le Conseil Scientifique et bien d’autres annonçaient dès mars que le virus reviendrait à la fin octobre pour une seconde vague plus dure que les précédentes. C’est comme si toutes les contradictions de cette hypothèse portée par les journaux avaient participé à étouffer la discussion et la possibilité de construire quelques vérités communes, quelques stratégies, de notre côté, indépendamment de ce qu’annoncent nos ministres. Les symptômes au long cours sont actuellement de plus en plus fréquents (y compris pour des personnes de 20 ou 30 ans). La maladie est décrite par plusieurs épidémiologues et virologues comme une infection de longue durée.
Aujourd’hui, les mesures de confinement partiel sont une façon de réduire les taux de contamination, afin de faire baisser drastiquement pendant un temps la circulation virale. Elles s’exercent à l’échelle de la population, de façon indifférenciée. Il est certain qu’elles ne peuvent être qu’inadaptées localement, et qu’elles ne renforcent en rien les pratiques de soin et l’attention aux possibilités de traitement. Le nœud, c’est qu’elles sont conçues comme mesures temporaires avant l’arrivée d’un vaccin, et l’on risque alors de basculer sur des formes d’individualisation des responsabilités, plus grande encore qu’aujourd’hui. La Chine vient de décider de rendre obligatoire la vaccination, par son vaccin national, pour toutes personnes voyageant hors de Chine. Dans le même temps, des débats à l’international sont en cours pour imaginer des visas d’immunité. La relance économique est en train de nous piéger dans l’alternative infernale entre restrictions drastiques à l’échelle nationale et responsabilisation individuelle à l’aide des vaccins. Dans un cas comme dans l’autre, on risque d’être perdants et malades. On retrouve l’alternative infernale, critiquer l’échec de la gestion ou l’extraordinaire rétrécissement des libertés.
Une vie bonne dans une vie mauvaise
Ici toutefois, il nous semble nécessaire d’insister sur le type de responsabilités qui est en jeu, et le rapport éthique qu’il nous faut affirmer. Le soulèvement suite à la mort de Georges Floyd aux États-Unis est apparu contre les divisions raciales et le peu d’espoir de mener une vie concédée à la population américaine racisée. Le refus de la mise au travail ne permet peut-être pas suffisamment de penser l’indignité et l’inégalité des vies. Il nous semble, pour conclure, que la question qui suit de Butler condense ces enjeux de la pandémie :
La plus individuelle des questions morales – comment est-ce que je mène cette vie qui est la mienne ? – a partie liée avec des enjeux biopolitiques distribués à travers des questions telles que quelles sont les vies qui comptent ? Quelles sont celles qui ne comptent pas comme vies, qu’on ne peut pas reconnaître comme des vies vivables, ou qui ne comptent que de manière ambiguë comme des vies ? »[30]
Les restrictions de mars à aujourd’hui nous interpellent singulièrement, « comment est-ce que je mène cette vie qui est la mienne? », cette vie qui est à la fois la mienne et quelque chose qu’il me faut mener mais dont les modalités ne m’appartiennent pas en propre, voire me sont imposées. Butler pose ces questions en repartant du questionnement d’Adorno, « peut-on mener une vie bonne dans une vie mauvaise? ». Précisons ici que la vulnérabilité, telle que l’affirme Butler, ne se réduit pas à la possibilité d’être lésé, blessé. « Toute forme de disponibilité à ce qui survient est à la fois une fonction et un effet de la vulnérabilité, qu’il s’agisse de la capacité d’ouverture à écouter une histoire qui n’a pas encore été racontée, ou de la réceptivité à ce qu’un autre corps endure ou a dû endurer, même quand ce corps n’existe plus. » La vulnérabilité concerne notre capacité à répondre, à nous mettre en capacité de répondre. « Ce que nous ressentons est partiellement conditionné par la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure »[31]. Butler interroge la perception du sujet libéral, de ce qui cadre nos perceptions. Le sujet libéral est celui qui est pris d’horreur devant certaines pertes et envahi d’un sentiment de bon droit devant d’autres. Dans les interventions militaires actuelles, si un état s’investit des atours de la démocratie, les morts qu’ils provoquent paraissent invariablement plus justes, ou du moins accidentelles. Les violences policières en sont un autre exemple. « Quand une population apparaît comme une menace directe pour ma vie, les vies qui la composent n’apparaissent pas comme « vies », mais comme ce qui menace la vie ».
Le philosophe Roberto Esposito a analysé comment les démocraties contemporaines fonctionnent sur un principe d’immunité. Dans le mot latin immunitas, il y a le terme latin munus, qui signifie tribut, don, charge. Il indique une dette jamais remboursable, une obligation mutuelle, et le contraire d’immun est commun. Faire partie d’une communauté implique d’être toujours liés, obligés les uns envers les autres, constamment exposés aux autres. Mais en « démocratie », la naissance fonde l’appartenance à la nation, et ceux qui sont inclus, indemnes, sont dégagés de toute obligation auprès des autres, extérieurs aux frontières. Pour citer Donatella Di Cesare, qui écrit « un virus souverain » publié à la Fabrique cette automne : « Le paradigme immunitaire est à la base de la froideur imperturbable que les immuns affichent face à la douleur des autres, non les autres en général mais les contaminables. Là-bas la douleur est un destin tracé, une inéluctabilité; ici le moindre malaise doit être apaisé, le plus léger trouble éliminé. Cela aussi c’est une frontière[32] ».
Les manifestations immunitaires et le racisme
Avant les manifestations actuelles de commerçants contre les mesures de confinement, ce printemps, on a vu des manifestants au Wisconsin américain ce printemps arborer des pancartes « arbeit macht frei » ou détourner le slogan féministe « mon corps, mon choix » en « my body, my choice, my work ». D’autres manifestations au Québec et en Allemagne affirmaient que tout ceci n’était qu’une « fausse pandémie ». Il faut prendre très au sérieux de telles affirmations. L’affirmation du bien commun par l’État ne répond pas au souci des autres et aux problèmes dont ces manifestants veulent être exemptés. Ils ne seront pas plus enclins à prendre en compte la crise climatique ou l’état catastrophique du monde qui a produit le virus actuel et nous en promet d’autres.
En même temps que les manifestations exigeaient de travailler dans le Wisconsin, des vidéos filmées à New York montraient des cadavres dans les couloirs des hôpitaux emballés dans des sacs de poubelles noirs et transportés dans des camions frigorifiques mobilisés pour l’occasion. En mars puis avril, de nombreuses photos ont circulé montrant les milliers de personnes sur la route en Inde, des cercueils de bois ou en carton à ciel ouvert dans les rues de Lima en Équateur. Ces images hantent, d’autant plus qu’elles ont disparu, sans suite. « Les récits peuvent nous amener à comprendre. Les photographies font autre chose: elles nous hantent » disait Susan Sontag[33]. Ces images sont restées sans réponses, sans être reprises, et sans qu’aujourd’hui il soit simple voire possible de savoir ce qu’il en était ou ce qu’il en est désormais. Les images ont circulé pour marquer les esprits, la hantise qu’elles laissent derrière elles reste à comprendre. Encore une fois, plutôt que de trancher, nous préférons garder ce passé comme l’avenir incertain.
Achille Mbembe[34] a utilisé, en repartant de la biopolitique analysée par Foucault, le terme de nécropolitique, que reprend également Norman Ajari dans son ouvrage « la dignité et la mort[35] ». Foucault distingue de la biopolitique la thanatopolitique, qui en est le devenir mortifère et qu’a incarné le nazisme. Le thanatopouvoir n’est plus seulement une action politique sur le vivant (comme le biopouvoir) mais une intervention qui ne prend plus que la forme de la mise à mort. Le terme de nécropolitique vise à désigner l’entre deux, l’indifférenciation ou le déplacement de la frontière entre la mort et la vie, l’espace de la production de vies qui n’en sont plus tout à fait, des vies indignes qui sont considérées comme ne méritant plus d’être vécues ni soignées (notamment en contexte colonial et postcolonial).
Dans « Mélancolie Post-Coloniale » (écrit en 2004 mais traduit et publié en français en septembre 2020 aux éditions B42), Paul Gilroy insiste sur la nécessité de « comprendre comment l’histoire du nationalisme politique s’est mêlée aux notions de race, de culture et de civilisation et comment la domination impériale et coloniale de l’Europe a fusionné nationalismes et racismes dans un amalgame qui nous affecte encore aujourd’hui ». Par l’idée d’une mélancolie post-coloniale, Paul Gilroy désigne la nostalgie pour la grandeur déchue d’une puissance impériale qui continue de hanter les discours des états nations aujourd’hui. Le slogan de la première campagne de Trump « Make America Great Again » est exemplaire, et celui de Boris Johnson en faveur du Brexit « take back control » l’est tout autant. Le retour en force des états nations comme entité politique d’intervention et de décision relance la centralité des passions nationales.
Dans « Capitalisme fossile[36] », le Collectif Zetkin montre combien dans le regain des mouvements nationalistes d’extrême droite chaque parti parle systématiquement du problème de l’immigration et du climat. Ce collectif montre combien « blanchité et hydrocarbure font la paire depuis longtemps ». Il y a, selon cet ouvrage, une corrélation entre le développement des énergies fondées sur l’extraction et la race. Dans toute l’Europe, l’immigration est souvent abordée, par l’extrême droite, comme une menace, une mise en crise possible de la nation, et les discours sur la crise climatique ou les limitations qu’il faudrait imposer participent également de cette diminution de puissance selon eux. Pour ces partis, « les combustibles fossiles sont bons pour les gens »[37] et il faut combattre les discours sur le changement climatique tout en insistant sur la nécessité de reprendre les frontières. Ces partis mènent une guerre au long cours pour dénier la catastrophe climatique, et ne rien de perdre leur emprise sur leurs ressources fossiles nationales. L’étude de leurs différents programmes dans le livre montre combien ils affirment la nécessité d’exploiter au maximum les ressources pétrolières pour se maintenir supérieur aux autres pays. Ils défendent d’ailleurs l’idée que « l’histoire contemporaine aurait basculé autour de l’année 1973 lorsque les pays arabes frappèrent l’Occident d’embargo pétrolier, paralysant les économies européennes »[38].
En revenant sur la logistique, la surcharge, l’incertitude en contexte de concurrence internationale, nous voulions insister sur une logique de contrainte par les infrastructures disponibles. Il ne s’agit pas seulement du nombre de lits, d’hôpitaux, de masques ou de soignants formés, mais de logique qui s’en tient à la capacité de réactivité et de coordination en temps réel, dans l’immédiat. Du fait que le virus circule mondialement, le choix a été pris de réagir par l’interruption plus ou moins coercitive selon les pays dès qu’une coordination à l’échelle européenne puis mondiale a pu sembler possible (aucun état-nation ne se serait risqué à un long confinement seul).
Nous espérons avoir montré qu’il nous faut être d’autant plus attentifs à la façon dont la protection de la vie s’exerce, mais peut-être moins en termes d’emprise souveraine et soudaine sur les corps individuels que sur la façon dont certaines vies sont plus dignes que d’autres, vie dénigrées et méprisées que toutes les réactions immunitaires veulent expulser ou faire disparaître. Alors qu’il semble de plus en plus difficile de mener une vie bonne dans une vie mauvaise (à l’échelle de la planète) les mécaniques du ressentiment mélancolique d’une pseudo-grandeur et garantie déchue rendent toujours plus lointaine la possibilité de solidarités concrètes, quelqu’en soit l’échelle. Les États-Nations ne produisent que des distinctions entre ami et ennemi, et les limites qui vont avec.
La suite du virus est incertaine, mais nous avons par contre de plus en plus affaire à des formes de déni de la catastrophe climatique, tout autant que de la catastrophe pandémique. Le virus faisant s’effondrer toutes les frontières et limites, cette absence revient comme un désir forcené de retour à ces mêmes limites. La mélancolie post-coloniale d’une grandeur déchue se traduit dans des élans nationalistes et protectionnistes. La sensation de vivre une vie difficilement vivable se retourne en ressentiment contre ceux qui en priverait les sujets blancs reconnus et garantis par l’état nation. Pourtant, la possibilité de mener une vie bonne n’existe que vécue avec d’autres, et reconnaître notre commune vulnérabilité revient à comprendre qu’il est impossible que l’autre soit destructible sans que je le sois aussi. À l’inverse, le sujet nationaliste mélancolique cherche à se produire ou se retrouver comme imperméable, protégé contre l’intrusion, il veille « jalousement sur son droit d’autoprotection souveraine[39] » . Cela peut sembler naïf de parler ainsi, mais pour citer Guy Debord, « le fascisme est un archaïsme techniquement équipé », et puisque celui-ci remonte il va nous falloir reconstruire la possibilité de croire au monde et aux autres.
[1] Bernard Aspe, https://www.terrestres.org/2020/11/06/crime-detat/
[2] Sandrine Aumercier, Clément Homs, Anselm Jappe et Gabriel Zacarias, De virus illustribus, éd. Crise et critique, août 2020. p.1.
[3] J’utilise la discussion entre Bernes et Toscano en ligne ici : https://drive.google.com/file/d/0B50Mf-NVA2afVkRkbmJpd3ctaUE/view reprise dans EndNotes 3: https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect
[4] Cf. Gilles Dauvé sur son blog, https://ddt21.noblogs.org/?page_id=2980.
[5] Fréderic Keck, Signaux d’alerte : contagion virale, justice sociale, crises environnementales : comment se préparer aux prochaines pandémies, Désclée de Brouwer, octobre 2020.
[6] notes des internes
[7] Philippe Pignarre, Comment faire ?, Seuil, septembre 2020.
[8] Ces exemples d’appuient sur le cours au Collège de France de Didier Fassin : https://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/seminar-2018-01-15-14h00.htm
[9] Cité par Didier Fassin dans Par ici la sortie, N°1, Seuil, juin 2020
[10] (l’économiste Philippe Aghion en a parlé)
[11] (auquel j’ai participé au sein du collectif éditorial des éditions des mondes à faire) / Collectif des éditions des mondes à faire, Sabu Kohso, Hapax, Yoko Hayasuke, Fukushima et ses invisibles, éd. Des mondes à faire, avril 2018.
[12] Ibid, p.19.
[13] Ibid.
[14] Girard Renaud, Jean-Loup Bonamy, Quand la psychose fait dérailler le monde, Gallimard, octobre 2020.
[15] Ibid.
[16] Ibid..p.17.
[17] Cf. https://acta.zone/interdire-les-visites-cetait-pour-que-les-familles-ne-voient-pas-dans-quelles-conditions-on-travaillait/
[18] Pour toutes ces citations cf. http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/le-seminaire/annee-2020-2021/seance-1-theses-sur-le-concept-de-travail-reprise/
[19] Judith Butler, Qu’est-ce qu’une vie bonne ?, Rivages, mai 2020. p.52.
[20] Cf. Didier Fassin, L’inégalité des vies, https://books.openedition.org/cdf/10093
[21] Op.cit. De Virus illustribus, p.13.
[22] Cf. https://www.macrobond.com/posts/new-mobility-data-google-citymapper-how-different-is-sweden-covid19/
[23] Idem. p.85.
[24] Ibid. p.85.
[25] Cf. Guillaume Le Blanc, Panique d’État, https://aoc.media/opinion/2020/10/29/panique-detat/.
[26] Op.cit. De virus illustribus, p.16.
[27] Comme l’a rappelé un ami, Denis Valiquette, dans des échanges personnels.
[28] Cf.https://www.terrestres.org/2020/09/30/les-medecines-terrestres-face-au-coronavirus/
[29] Cf. https://inf-covid.blogspot.com/.
[30] Op.cit, qu’est-ce qu’une vie bonne ?, p.52-53.
[31] Idem. p.45.
[32] Donatella Di Cesare, un virus souverain, La Fabrique, octobre 2020.
[33] Citée par Judith Bulter, Ce qui fait une vie, Zones, p.100.
[34] Achille Mbembe, Nécropolitique, Raisons politiques 2006/1 (no 21), pages 29 à 60
[35] Norman Ajari, La dignité ou la mort, La découverte.
[36] Zetkin, Capitalisme fossile, La Fabrique, octobre 2020.
[37] Idem, p.33.
[38] p.58.
[39] Op.cit. ce qui fait une vie, p.51.
Pour se reporter à la première séance du séminaire 2020/2021 : https://laparoleerrantedemain.org/index.php/2020/11/05/theses-sur-le-concept-de-travail-bernard-aspe/
Et aux années précédentes : http://ladivisionpolitique.toile-libre.org/


